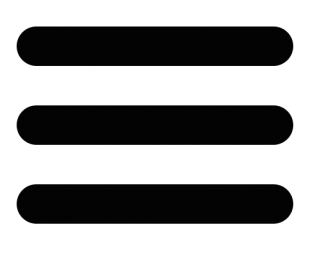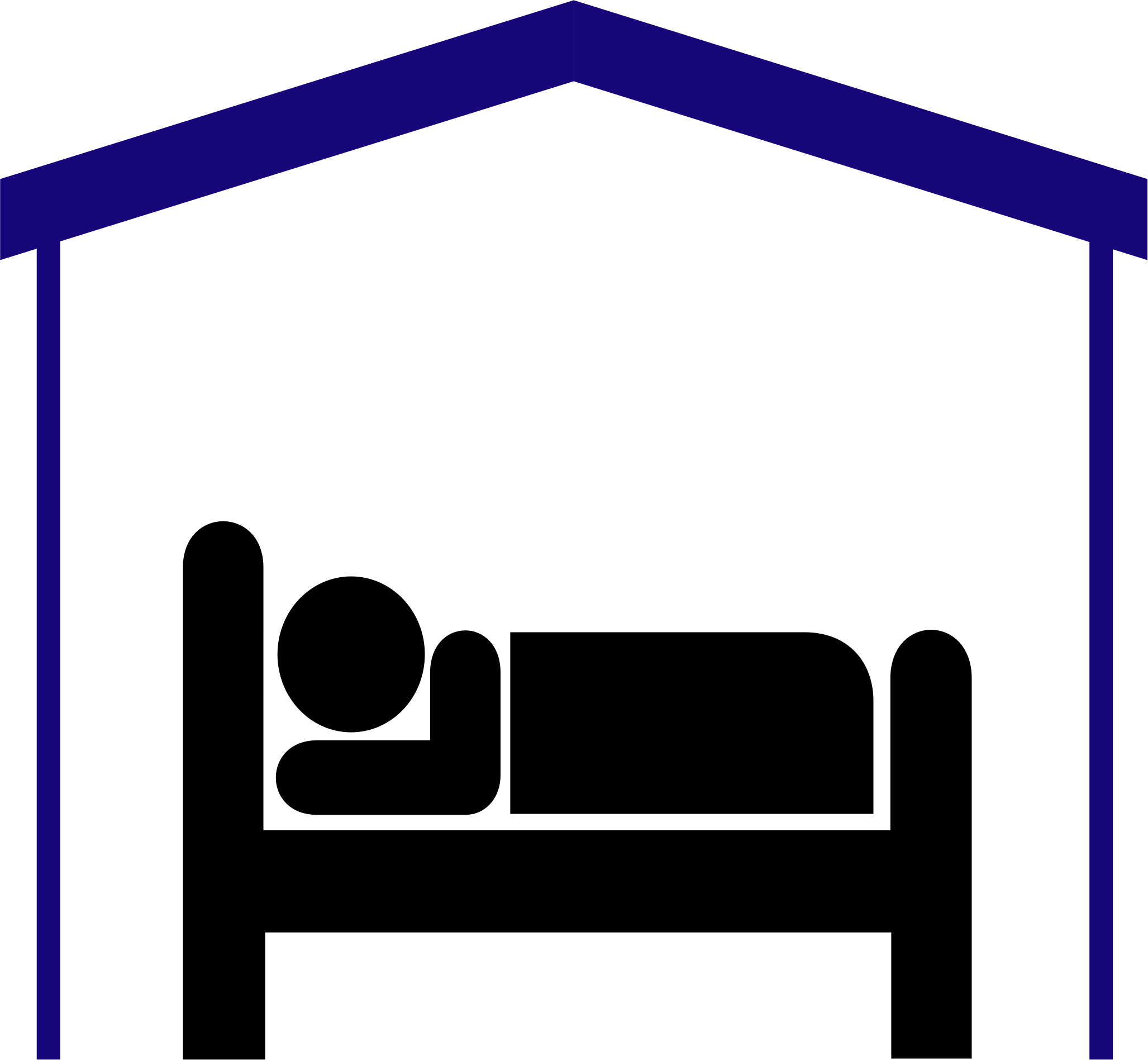Connaît-on bien les Etats-Unis ?
L’Amérique change sous nos yeux à vive allure. Depuis le début des années 1970, la croissance du PIB est certes plus rapide en Amérique qu’en France, mais celle de la population l’est aussi ; le résultat, c’est que l’évolution du PIB par habitant est similaire dans les deux pays : environ 2 % par an. De plus, le surcroît de richesse créé par les années de croissance a été intégralement distribué aux plus riches et n’a pas amélioré le sort de la majorité. La mobilité sociale n’est pas, contrairement aux idées répandues, plus élevée que dans beaucoup d’autres pays. L’Amérique deviendrait-elle infidèle à son idéal d’égalité des chances ?
Des inégalités croissantes
Les Etats-Unis sont l’un des pays les plus riches de la planète mais aussi parmi eux, l’un de ceux où les inégalités sont les plus prononcées. Depuis deux décennies, elles n’ont cessé de se creuser : les working rich ont remplacé les rentiers au sommet de l’échelle sociale.
Depuis 1980, en effet, la croissance des revenus des familles est presque totalement concentrée sur les 5% les plus élevés de l’échelle des revenus : en termes réels, la moitié la plus pauvre de la population gagne aujourd’hui à peine plus qu’en 1980 ; le salaire minimum fédéral n’a progressé que de 35 % pendant la même période, passant nominalement de 3,80 dollars à 5, 15 dollars par heure, sans changement du pouvoir d’achat. À l’inverse, les 5 % des familles les plus aisées ont vu leurs revenus doubler.
Constat de la différence entre le degré d’inégalité observé et la perception de ces inégalités : le coefficient de Gini, la mesure synthétique la plus répandue des inégalités, est plus élevé pour les Etats-Unis (plus de 0, 35 contre 0, 25 en Allemagne et en France), indication que les inégalités y sont plus prononcées. Mais la situation subjective est inverse : le pourcentage de ceux qui jugent les inégalités excessives est de 60 % en Amérique contre 75 % en Allemagne et 85 % en France.
Fortes inégalités également pour les retraités, les personnes âgées de plus de 65 ans, malgré un système de retraite alliant financement par répartition et financement par capitalisation. Le taux de pauvreté des plus de 65 ans est l’un des plus élevés des pays industriels.
De plus, la pauvreté progresse : 37 millions de personnes, soit 12, 6 % de la population, seraient dans une situation de pauvreté absolue, malgré les programmes sociaux.
Cette population pauvre semble suivre le flot de la consommation de masse (78 % des pauvres possèdent un magnétoscope et un lecteur de DVD). Ils représentent aussi une part croissante des ménages propriétaires de leurs maisons. Mais le revers de la médaille est une mauvaise hygiène de vie : malnutrition, obésité, diabète, un tiers n’a pas accès à l’assurance maladie. Beaucoup font face à un endettement massif : près d’un tiers des familles pauvres consacrent plus de 40 % de leurs revenus au paiement de leurs dettes. Le taux de working poor atteint 5, 3% , soit 7, 4 millions de personnes.
Il apparaît ainsi que les Etats-Unis sont l’un des pays développés où la pauvreté est aujourd’hui la plus persistante : 9, 5 % des Américains sont constamment restés au-dessous de 50 % du revenu médian pendant les trois dernières années, un taux trois fois supérieur à celui de la France.
Une mobilité sociale décroissante
Aux Etats-Unis, la pauvreté est un échec personnel : 60 % de la population pensent que les pauvres sont pauvres parce qu’ils sont paresseux, 29 % parce qu’ils sont enfermés dans le piège de la pauvreté ; les pourcentages sont inverses en Europe. La pauvreté en Amérique est d’abord un échec personnel.
Contrairement à une idée reçue, il semble que la mobilité sociale soit plutôt inférieure à ce qu’elle est en Europe. En suivant une même cohorte sur une longue période (1974-1991) la proportion de ceux qui ne parviennent pas à sortir du premier quintile (les 20 % les plus pauvres) est de 50 %. Plus troublante, une étude portant sur une cohorte de 5000 personnes, pères et fils, entre 1979 et 1998 a établi que 70 % des fils étaient dans la même position sociale que leur père en 1979 ou dans une position inférieure. Plus troublantes encore, les comparaisons avec d’autres pays du Luxembourg Income Study Group montrent que la corrélation entre les revenus des pères et ceux des descendants est plus élevée aux Etats-Unis que dans des pays comme l’Allemagne, la Finlande ou le Canada. Selon deux économistes Alberto Alesina et Edward Glaeser, Understanding Poverty, Harvard University Press, 2001, « la mobilité sociale est aujourd’hui à peu près la même des deux côtés de l’Atlantique et, pour autant qu’on puisse le dire, il en a presque toujours été de même. »
L’offre de services, responsable ?
Ces services sont fournis aux Etats-Unis selon des conditions plus directement soumises au marché qu’en Europe continentale, donc plus inégalitaires (rappelons tout d’abord que l’inscription au College à Harvard coûte 42 000 dollars par an. Sur quatre ans, le coût est donc de 168 000 dollars !). L’histoire de l’enseignement aux Etats-Unis est celui d’un succès sans égal. Il n’y a pas d’exemple plus spectaculaire de démocratisation de l’enseignement supérieur que le GI Bill (22 juin 1944). Il assurait l’assistance du gouvernement fédéral à tous les combattants du second conflit mondial : plus de 8 millions de vétérans allaient en bénéficier, 2, 5 millions allaient décrocher un diplôme.
Ultérieurement, le Higher Education Act (1965) fixait pour objectif qu’aucun étudiant ne soit contraint de renoncer à l’université pour des raisons financières.
En réalité, payer des études supérieures aux Etats-Unis est devenu de plus en plus difficile depuis le début des années 1980. Selon des données de l’US Department of Education, la moyenne de l’ensemble des frais de scolarité, de logement, et de nourriture pour un étudiant undergraduate (de bac + 1 à bac + 4) à temps plein a plus que triplé (+ 68 % après correction de l’inflation) entre 1979-1980 et 1996-1997, passant de 2809 dollars à 9206 dollars par an.
Cette majoration des frais d’entrée intervient dans un contexte marqué par une réduction drastique depuis 2001 des budgets publics en faveur de l’enseignement supérieur. Deux indicateurs : le montant des dépenses publiques par étudiant a reculé de 6875 dollars à 5720 dollars entre 2001 et 2004 ; le pourcentage du budget des États dédié à l’enseignement supérieur a reculé de 6, 7 % il y vingt ans à 4, 5 % aujourd’hui. Or, ces universités publiques ont joué un rôle majeur dans la consolidation de la classe moyenne aux Etats-Unis dans le passé.
Dans ces conditions, l’accès aux études supérieures se trouve, pour de plus en plus d’étudiants, conditionné par l’obtention d’une ou plusieurs aides financières (État fédéral, États, institutions privées de philanthropie, établissements scolaires). Ces aides sont de plus en plus attribuées sur la base du mérite scolaire plutôt que de se concentrer sur le soutien aux familles aux plus faibles revenus.
Le taux d’inscription à l’université des étudiants issus de familles à bas revenus reste en conséquence faible et ne corrige pas l’inégalité des situations sociales initiales : en 2003, le taux d’inscription à l’université des 18-24 ans dépendant financièrement de leurs familles était de 27, 9 % pour les familles à faibles revenus (revenu annuel inférieur à 20 000 dollars), de 39, 4 % pour les familles à revenus intermédiaires et de 55, 9 % pour les familles à plus hauts revenus (50 000 dollars et plus par an)
À l’inverse, les écoles primaires et secondaires sont gratuites et 90 % des enfants y sont inscrits. Mais un système de sectorisation détermine l’établissement auquel sont rattachés les enfants et le financement des écoles publiques est pour l’essentiel assuré par la taxe foncière. Les moyens dont disposent les écoles dépendent largement du revenu moyen des habitants du quartier. Il s’établit ainsi un lien étroit entre les prix sur le marché immobilier et la qualité des établissements scolaires.
Depuis le 8 janvier 2002 est entré en vigueur le mandat éducatif « No Child Left Behind Act » : « s’assurer que tous les enfants aient une chance égale et significative d’obtenir une éducation de grande qualité, et qu’ils puissent atteindre un niveau de compétence rencontrant les critères de réussite académique étatique. » Mais se pose le problème des crédits accordés aux États, insuffisants, et des pénalités en cas de non respect des critères (suppression des subventions). D’où une compétition accrue entre élèves, établissements, États, génératrice de stress et de rigidités (durcissement des critères).